Enseigner la littérature de jeunesse à l’Université
Courageux, je prétends l’être, puisque vivent en moi les déterminations du Petit Poucet, de Tintin, de Fifi Brindacier, et de bien d’autres encore.
Pourtant, j’étais mou et mal quand je me dirigeais, ce matin-là de février 2009, de mon bureau à la salle de cours, pour donner mon premier séminaire de littérature de jeunesse à l’Université de Lausanne.
D’ordinaire, un prof qui gagne sa salle, c’est une pensée qui vogue, selon des protocoles bien éprouvés : il faut avoir le pas vif mais non précipité, pour attester qu’on est porté par une passion maîtrisée et réjoui de la communiquer, même à huit heures le matin. Le regard, lui, doit être légèrement voilé afin d’exprimer que, là-derrière, ça cogite sans repos. Mais les ambassadeurs de l’excellence professorale sont les livres que l’on emmène. L’idéal, qui ne s’atteint qu’après des années, c’est d’en tenir un seul, d’une main, un peu comme un ancien bougeoir, afin que son titre rayonne. Proust, ça éclaire. Mallarmé, à peine moins. Mais on peut aussi captiver par l’audace : Justine, du Marquis de Sade. Ou le rare : Les déliquescences, poèmes d’Adoré Floupette.
Or, ce matin-là, je n’avais pas assez des deux bras tendus pour déménager une tour improbable aux couleurs criantes : La nuit du grand méchant loup, Péric et Pac, Histoire d'une petite souris qui était enfermée dans un livre, L’Ecoute-aux-portes, L'ogre nouveau est arrivé, Mona et le bateau-livre, et deux douzaines de cet acabit. Négligence due au stress, ma tour avait pour toiture L’art du pot, album grand format de Jean Claverie et Michelle Nikly (Albin Michel, 1990), ou un bambin fier de son résultat durement acquis exhibait le contenant et le contenu comme un trophée.
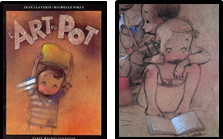
J. Claverie & M. Nikly (1990). L’art du Pot. Paris : Albin Michel. ©
La salle de cours que j’atteignis les genoux en X fut un havre bien provisoire. Car une vingtaine de regards interrogeait, goguenarde, ma manière d’installer ma tour branlante sur le pupitre. C’est bien plus facile de déposer d’un geste aérien La Princesse de Clèves…
Pendant que je tentais de retrouver mon assiette, mon for intérieur, mon éthique professionnelle continuaient de trembler.
Certes l’Université n’avait pas attendu ma modeste audace pour ajouter «de jeunesse» à un intitulé de cours. Mais on avait jusqu’alors surtout retenu des œuvres patrimoniales qui convenaient aussi aux plus jeunes lecteurs, des récits dont les héros sont souvent des enfants ou des adolescents (Les Contes de Perrault, L’Enfant de Vallès, Poil de Carotte, Le Petit Prince, Le Grand Meaulnes,…).
Les enfantines histoires que j’amenais pourraient-elles former et intéresser des étudiants généralement sérieux, investis et soucieux de réussir ?
Des chiffres aident à mesurer l’impact de mon choix : pour une Maîtrise de français en branche secondaire, le cursus académique minimal compte une dizaine d'œuvres littéraires donnant lieu à des analyses spécifiques et une trentaine de livres abordés dans une perspective historique. En branche principale, et sans compter la bibliographie du mémoire, il faut ajouter entre dix et trente titres, suivant les intitulés des cours et suivant les spécialisations ou options retenues. De quelles prétentions pouvaient s’enorgueillir ces minces albums pour confisquer un des six séminaires obligatoires de la Maîtrise ? Comment allaient-ils résister à des grilles d’analyses détaillées, à des lectures multiples, à des exposés et à des écrits savants de plus de vingt pages ?
Eh bien, ce premier séminaire de master allait apporter tant à la formation que j’ai récidivé, convaincu de l’apport exceptionnel de la littérature de jeunesse dans une cursus académique en Lettres. Récidivé en aggravant même mon geste, puisque, en 2015, j’ai ajouté à la liste de lectures des pop-up, des abécédaires, des livres sans textes et des albums numériques qui rajeunissaient encore le premier public de ces ouvrages : davantage destinés aux enfants non lecteurs qu’aux lecteurs autonomes.
K. Komagata (2011), Du bleu au bleu. Paris : Les Trois Ourses. ©
Selon une habitude éprouvée, j’essaie de confronter immédiatement les étudiants [1] aux œuvres retenues. En 2009, nous avons commencé par une lecture collective du célébrissime Yakouba, (Seuil Jeunesse, 1999) de Thierry Dedieu et, en 2015, par le malicieux et délicieux album de Lane Smith, C’est un livre, (Gallimard Jeunesse, 2011), dans sa version papier et dans sa version animée [2]. Dans les deux cas, le sourire de la découverte s’est plissé : la multimodalité de tout album pointe immédiatement les difficultés à décrire et commenter l’image fixe ou animée, à la conjuguer avec le texte et les paroles des personnages. Bref, les étudiants ont vite mesuré leur (notre) important déficit sémiotique : nos parcours scolaires nous spécialisent au mieux sur le texte, alors que la culture contemporaine repose de plus en plus sur l’image, le son et leurs interactions. Faute de méthode et de vocabulaire spécifiques pour les «faire parler», l’image et le son apportent en général un forfait, un tout émotif lapidaire («gais», «tristes»,…), alors que, dès qu’ils sont mieux connus, leurs codes déclinent des nuances de sens, de sentiment et d’interprétation presque inépuisables.
Mais si l’album de jeunesse constitue un parfait petit laboratoire, bien équipé, pour introduire à la littérature multimodale, il n’est pas pour autant un moderniste irréfléchi : au contraire, il interroge incessamment le statut du livre, son histoire aussi bien que son avenir. Qu’il s’agisse des abécédaires qui réinterprètent avec les moyens graphiques et techniques d’aujourd’hui la naissance de l’écriture occidentale, qu’il s’agisse des livres-objets ou encore des explorations de nouvelles formes de narration, tous ces albums consolident le livre imprimé en le frottant, par dialogue, aux possibilités du livre numérique d’aujourd’hui (les livres dits augmentés) et aux livres véritablement numériques de demain, c’est-à-dire à ceux qui résulteront plus spécifiquement du langage numérique.
Quelques titres pour témoigner de la réactualisation du livre et de son dialogue serein, confiant, avec le livre numérique : La mise en scène élégante de la lettre ABC3D de Marion Bataille, l’émouvante participation du papier (les grammages différents, l’embossage, les transparences,…) au thème de la disparition dans Lundi (Casterman, 2004) d’Anne Herbauts ; cette œuvre totale, L’Herbier aux fées (Albin Michel, 2011) où, pour des jeunes d’au moins dix ans, Benjamin Lacombe et Sébastien Perez, usent de ressources équivalentes entre le livre papier (découpages, transparences,…) et le livre augmenté (minis courts-métrages, musique,…) pour ébranler la rationalité des lecteurs/spectateurs ; ou encore les déconstructions et reconstructions enjouées de l’objet imprimé par Le livre avec un trou (Bayard Jeunesse, 2011) d’Hervé Tullet et, du même, les explorations déjantées et pourtant habiles du récit classique dans son Sans titre (Bayard Editions, 2012).
L’album introduit aussi dans la fabrique concrète du livre contemporain, dans son économie : il est fréquent que, de sa conception à son impression, deux ou trois continents soient impliqués. Et l’Asie n’est seulement que le continent de la main d’œuvre bon marché, mais un creuset de création et d’art. Pour le meilleur (la découverte d’auteurs de qualité) ou le pire (le tout-venant commercial), le livre de jeunesse voyage, créant ainsi du lien dans une génération à l’échelon mondial tout en suscitant des réceptions variables selon les langues et les pays. De ce point de vue, les prés carrés, les nationalismes fiers et ou encore la francophonie semblent étroits et dépassés.
Si un lecteur professionnel est bien celui s’estimera être d’autant plus nourri, enrichi par une œuvre artistique qu’il a su identifier et faire participer à son interprétation toutes les composantes de forme et de sens , je peux aujourd’hui affirmer que certains de ces albums ont engendré auprès des étudiants (et du prof !) des effets qui ne cèdent en rien à ceux des livres du patrimoine. Les questions qu’ils posent, les valeurs qu’ils discutent, les ambiguïtés fertiles qu’ils mettent en récit sont indépendantes de l’épaisseur du l’œuvre, des supports et des modes sollicités, et du public visé.
Le dernier cours donné, j’ai donc regagné mon bureau en jonglant avec L’Art du pot et L’Art de lire. [3]
J. Claverie & M. Nikly (1990). L’art du Pot. Paris : Albin Michel. ©
J. Claverie & M. Nikly (1990). L’art de lire. Paris : Albin Michel. ©
Par Noël Cordonier, Professeur HEP honoraire, noel.cordonier@hepl.ch
Chronique publiée le 20 mars 2017
[1] Ici et ailleurs, le masculin est à valeur générique.
[2] Pour se faire une idée : http://www.dailymotion.com/video/xgudh2_c-es%20t-un-livre-lane-smith_creation
[3] Jean Claverie & Michelle Nikly, L’Art de lire, Albin Michel, 2001.





