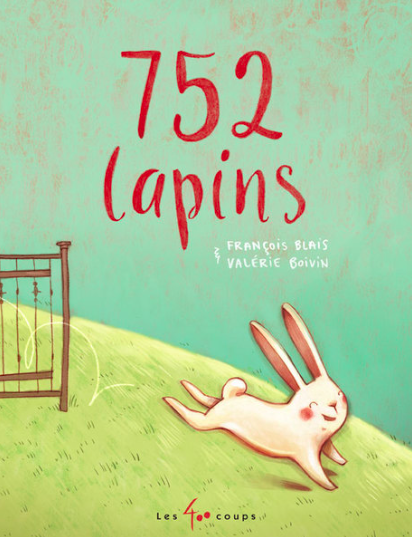Une maison d’édition québécoise et trois perles à découvrir au-delà des frontières
Les 400 coups : qu’on les ait faits ou qu’on ait rêvé de les faire, on convoque souvent l’expression pour décrire une époque révolue, appariée à la jeunesse, à l’insouciance, à une forme de témérité qu’on admire peut-être secrètement. Est-ce pour référer à ces connotations positives qu’une maison d’édition québécoise a pris le parti de se nommer ainsi ?
Lorsque j’ai posé cette question à Simon de Jocas – le directeur général des éditions « les 400 coups » (www.editions400coups.com) – ce dernier a immédiatement évoqué le film éponyme de François Truffaut, ainsi que l’idée d’audace qu’on lie intrinsèquement à cet imaginaire. S’éloigner du convenu semble constituer l’une des devises du fondateur des éditions, Serge Théroux, en 1995, dans une variété de genres : essais littéraires et politiques, poésie, bande dessinée, récits et bien sûr, littérature pour la jeunesse. En 2013, les éditions sont rachetées par Simon de Jocas, qui resserre le catalogue en misant exclusivement sur les albums jeunesse, tandis que les publications destinées aux adultes trouvent un second souffle aux éditions « Somme toute » (www.editionssommetoute.com). La ligne éditoriale des publications labellisée « les 400 coups » demeure inchangée : des histoires qui déstabilisent, qui se détournent de toute visée moralisatrice, qui portent un message subtil tout en laissant de la place à la créativité du lecteur ou de la lectrice. Des histoires qui viennent chatouiller l’âme. Parmi les collections dont Simon de Jocas parle avec enthousiasme, figurent la collection « Mes premiers coups » et « Mémoires d’images ». La première vise un public de tout-petits, avec des livres « tout-carton », et se veut une initiation au récit. Les albums réfèrent à une mémoire aristotélicienne : un récit est le passage d’un état à un autre, une succession d’actions prenant place entre les deux. Autrement dit, ces albums sont construits sur le modèle « début-milieu-fin ». A priori, cela peut paraître banal, mais cela ne l’est définitivement pas : l’initiative des éditions « Les 400 coups » mérite d’être soulignée. La didactique de la littérature a documenté l’importance de lire et de faire lire à des enfants et à des élèves de tous âges des textes littéraires résistants (Tauveron, 2001 ; Richard, 2019) : or, le marché éditorial propose majoritairement des imagiers pour les enfants très jeunes. La collection « Mémoire d’images », quant à elle, explore le genre documentaire, en racontant des moments qui ont fait l’histoire canadienne, à partir de documents d’archives. C’est le genre docu-fiction qui est exploré ici, avec des thématiques certes spécifiques à ce pays, mais à partir desquelles on pourrait aisément ouvrir à des problématiques actuelles et urgentes, telles que les enjeux de la migration ou encore le travail des enfants.
Revenons à www.voielivres.ch : pourquoi (et comment) choisir une maison d’édition, qu’on mettrait en lumière ? La question nous a régulièrement habités, sans qu’on ne trouve de réponse véritablement satisfaisante. Comment mettre en valeur une maison d’édition, sans avoir l’impression de prétériter les autres ? Comment installer une forme d’équité dans les maisons d’éditions représentées ? Comment être le plus « juste » possible ? Comment sortir de notre propre conditionnement qui nous amène (inlassablement, certes, mais aussi pour notre plus grand plaisir) vers des genres de textes, des traitements graphiques, une poésie du phrasé qui forment une grande famille très cohérente, mais peut-être moins marquée par la diversité des publications actuelles ? Bref, voilà le type de questions qui nous préoccupent, alors que mon choix du jour prend une option claire : parler des éditions « les 400 coups », un point c’est tout. Paradoxe ? Plutôt hasard et chance : ils ont un rôle important à jouer dans la genèse de cette chronique. Il se trouve que je suis présentement installée dans une région du Canada anglophone et que la bibliothèque publique est devenue l’un des endroits incontournables de mon rythme hebdomadaire. Et dans cette bibliothèque publique, il y a un coin francophone. L’autre jour, en quête d’une idée pour une chronique, j’ai laissé mon regard s’attarder sur ce rayon-là, en espérant dénicher une perle. J’en ai trouvé trois. J’ai remarqué en les lisant que les trois avaient été publiés par la même maison d’édition : j’y ai vu un signe. Donc, voilà une chronique « située », dans le sens qu’elle opère un choix et qu’elle assume ce dernier. Partons maintenant à la découverte de ces trois albums.
« Un après-midi chez Jules » (Boivin, 2013) raconte l’histoire d’un petit garçon qui déménage d’une « toute petite maison » à une maison qui a tant de pièces que « Jules n’a pas assez de doigts pour toutes les compter ». Sans surprise, Jules s’ennuie, il est seul. Après avoir tenté de s’amuser sans y parvenir (la scène de la collection de moustaches italiennes, chinoises et bulgares est cocasse), le garçon décide finalement de fabriquer des avions en papier et de les lancer sur des passants afin de créer du lien avec les autres, tout en étant protégé par les murs de sa maison. Un jour, à son réveil, un avion en papier entre par la fenêtre ouverte et se pose sur le lit de Jules. On aime la fin du livre qui interpelle le lecteur ou la lectrice et l’invite à choisir l’identité de l’expéditeur ou de l’expéditrice de l’avion, autrement dit, l’identité du futur ami potentiel de Jules.
Au-delà du thème du déménagement et de la solitude, c’est celui du temps qu’on a envie de lire ici. Le temps, qui nous fait passer d’un état (la solitude) à un autre (la relation à autrui). Le temps qui s’étire, alors que l’enfant cherche une occupation qui lui rendrait le sourire. Le temps, enfin, et sa lenteur qu’on doit parfois accepter : se faire des amis, ça prend plus qu’une page ou deux d’albums. Le fait que l’ouvrage ne se termine pas sur une rencontre avérée mais sur une promesse de rencontre dit toute la fragilité du lien à tisser et à entretenir.
La temporalité structure également le deuxième album, comme si elle opérait une rupture dans la narration. « Sous le parapluie » (Buquet & Arbona, 2016) offre un récit un peu plus attendu, puisant à des motifs classiques et – avouons-le – pourvoyeurs d’une poésie qui fait du bien. L’album débute avec des doubles pages dans les tons sombres, qui caractérisent une météo pluvieuse, mais également l’humeur maussade d’un homme qui tient un parapluie. Le vent est parfois si tempétueux que l’homme disparaît derrière la voilure. Sur ces planches-là, le discours indirect libre prend le relai d’un personnage au visage caché : « Maudit soit ce temps gris ! », « Foi de citadin, on n’a jamais connu pareil temps de chien ! », ou encore « Mais c’est un vrai cauchemar, en plus d’être mouillé, il va être en retard ! ». Son chemin croise celui d’un petit garçon, en admiration devant la vitrine d’une pâtisserie. Les planches suivantes contrastent, tant dans les coloris (jaunes, rouges, flamboyants) que dans le rythme du texte : « Sur des dentelles de papier, la crème déborde, les ganaches brillent. L’enfant a les yeux qui s’écarquillent. » A la place des parapluies qui prenaient une place disproportionnée sur la double page, ici, ce sont les gâteaux qui dansent au premier plan. La suite, on la devine. Le vent arrache le parapluie au grincheux. L’enfant le ramasse. Les deux personnages se rencontrent. L’homme, attendri par l’enfant, lui achète un gâteau. L’enfant le partage avec l’homme. Et là, sous le parapluie, devenu rouge vif, « le temps semble arrêté. Il pleut sur la ville, le ciel est bas, les rues fourmillent. Mais pour l’homme et l’enfant, en cet instant, rien de tout cela n’est important ». La double page finale, sans texte, montre les deux personnages comme s’ils s’envolaient dans un ciel estival, gâteau et parapluie à la main.
En lisant cet album, on pense à la relativité du temps. Alors que l’homme se désolait de son retard, et alors que le texte et l’image disaient l’urgence, le même temps semble suspendu lorsque se déroule la rencontre avec le petit garçon. Mais on pense également à ces moments précieux qu’il faut chérir, ceux qui sont constitutifs d’une expérience fondatrice, disait Walter Benjamin, au contraire de ceux, banals, qui ne sont qu’une addition d’épisodes sans incidence sur qui nous sommes.
Mais s’il ne fallait retenir qu’un album, ce serait « 752 lapins » (Blais & Boivin, 2016). Le récit commence par un traditionnel « Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse… ». L’incipit place un horizon d’attente : chic ! On va lire un conte ! Mais cette princesse, qui était « très belle, très gentille, très riche et qui sentait très bon », semble dès la première phrase contrevenir aux canons du genre. On insiste un peu trop sur ses qualités : la répétition à quatre reprises de l’adverbe « très » est suspecte... La suite du récit nous apprend que cette princesse possédait 752 lapins et qu’elle consacrait « sa fortune à entretenir et à augmenter son clapier royal ». Une princesse, donc, bien consciente des réalités matérielles et apte à faire fructifier son patrimoine. L’élément perturbateur arrive : un jour, un serviteur négligent oublie de fermer la barrière du parc et l’un des 752 lapins s’enfuit. Tristesse, cris, pleurs : la princesse est désespérée. Ses amis des royaumes voisins lui prodiguent des conseils : occuper son esprit à autre chose, afin de retrouver sa bonne humeur, se contenter des 751 lapins restants, ou encore se faire couler un bon bain, se servir un grand verre de limonade et lire un bon livre, afin de se changer les idées… et d’oublier le pauvre animal ! Au départ de ses amis, la princesse semble offusquée : « on voit qu’ils n’ont jamais aimé pour parler de la sorte ! J’avais 752 lapins, oui, mais j’aimais chacun d’entre eux aussi fort que s’il était mon seul lapin ». La princesse chausse ses bottes et se rend chez une vieille magicienne, qui lui révèle les épreuves à traverser pour retrouver son lapin : affronter un géant, gravir de hautes montagnes, traverser un marais infesté de serpents, endurer le froid, la peur et la faim. L’épreuve semble à la hauteur des meilleurs récits de chevalières de la table ronde. Et alors qu’on attend un preux message valorisant l’absolue unicité et l’ultime importance de chacun, le courage et la bravoure d’une noble princesse pour retrouver son lapin perdu, l’histoire détourne les codes – pour notre plus grand bonheur. Après réflexion, la princesse met en balance les périls qui l’attendent et le fait qu’il lui reste tout de même 751 lapins. La double page finale la dévoile plongée dans un bain moussant, sirotant une limonade, son livre préféré à la main : heureuse ! Le récit invite le lecteur et la lectrice à réfléchir sur la notion de risque : peut-être s’agit-il de renoncer à certains accomplissements lorsque les épreuves semblent trop intenses. Risquer sa vie, pourquoi pas – mais pas pour un lapin.
Au-delà de la parodie de conte merveilleux, où la quête de la princesse se transforme en renoncement non pas déceptif, mais délicieusement égocentrique, on peut également lire dans ce récit une transformation du rapport à la temporalité. On le sait dès la fin du 18e siècle, depuis que les libéraux nous l’ont appris : le temps c’est de l’argent. A une princesse qu’on devinait essentiellement tournée vers la croissance économique, succède un personnage qui fait le choix d’une exquise paresse, d’une (in)activité, donc, à l’encontre de la productivité et de la rentabilité. On verrait bien cet album comme le support à une discussion en classe sur l’accumulation de biens de consommation : pourquoi 752 lapins et pas… 2 ? pourquoi 6 paires de baskets et pas 1 ? Sans qu’un tel message écologique ne soit explicitement nommé, on ne pense pas faire violence au texte en suggérant qu’il porte en lui les germes d’une telle réflexion.
Prendre du temps pour soi : comme Jules qui s’ennuie et qui parvient à imaginer une manière d’entrer en contact avec les autres, comme l’homme au parapluie qui redécouvre la capacité de s’émerveiller et de laisser le temps s’étirer, comme la princesse, finalement, qui « se » préfère à l’aventure du « toujours plus ». Et si c’était ça, aussi, faire les 400 coups, dans notre monde contemporain ?
Albums cités :
Boivin, Valérie (2013). Un après-midi chez Jules. Montréal : Les 400 coups.
Blais, François & Boivin, Valérie (2016). 752 lapins. Montréal : Les 400 coups.
Buquet, Catherine & Arbona, Marion (2016). Sous le parapluie. Montréal : Les 400 coups.
Par Sonya Florey, professeure ordinaire HEP, UER Didactique du français, HEP Vaud, sonya.florey@hepl.ch
Chronique publiée le 23 septembre 2019